Portrait d’un baron français ayant œuvré pour le dialogue des culturesPar Faouzi BentaraLe baron d’Erlanger symbolisant l’ouverture d’esprit et le dialogue des cultures, un atelier de musique vandopérien, né il y a dix ans, porte son nom. Portrait d’un homme méconnu que rien ne prédestinait à se passionner pour la musique arabe.
"De tes précieux bienfaits les Arts et les Lettres se souviennent, Et des larmes sont versées à ta mémoire par la musique arabe. Par tes soins, elle renaît, immortelle, et embellit de sa parure les siècles ; Baron, tu as tourné le dos à la vie, et, t’élevant dans le ciel, tu as disparu. Ton souvenir sera gravé dans notre mémoire, et nous le perpétuerons comme un devoir ; C’est là un témoignage de la fidélité de l’Art à son Père Spirituel".
Ce poème, traduit de l’arabe, constitue le témoignage de reconnaissance de l’Association de la musique tunisienne qu’on peut lire sur la pierre tombale du baron d’Erlanger, décédé à Tunis le 29 octobre de l’année 1932 à l’âge de soixante ans.
Le baron Rodolphe d’Erlanger, né le 7 juin 1872 à Boulogne, dans une famille de riches banquiers, passe les vingt dernières années de sa vie à Sidi Bou Saïd (le nom de cette bourgade aux environs de Tunis serait celui d’un marabout tunisien du nom de Abou Saïd El Béji, 1160-1231) [
1]. D’Erlanger fait construire à Sidi Bou Saïd un palais selon les normes de l’architecture andalouse - avec notamment la participation d’ouvriers marocains - et il appelle son palais Ennejma Ezzohra, "l’Etoile de Vénus".
Dans ce lieu prestigieux, d’Erlanger s’adonne à la peinture (précisément, en tant que portraitiste orientaliste), s’entoure de musiciens de l’époque, d’origines diverses et s’initie à la cithare sur table (le qanoûn). Il s’intéresse également aux traités musicaux arabes du Moyen-âge et finit par entamer son projet colossale qui prévoit, entre autres, la traduction de ces traités en français, la collecte et la transcription des répertoires musicaux de son époque.
Ses travaux et son intérêt pour la musique sont d’une importance telle que Farouk, le roi égyptien de l’époque, le charge de la préparation du Ier Congrès de la musique arabe, qui se tient du 28 mars au 3 avril 1932. D’Erlanger y travaille avec l’aide de musiciens tunisiens et proche-orientaux, ainsi que du baron, arabisant, Carra De Vaux. Malheureusement, sa santé ne lui permet pas de se rendre au Caire pour participer au congrès ; il décède le 29 octobre de la même année.
Grâce à ses collaborateurs, notamment son secrétaire Mannoubî Snoussî, le musicologue Henri George Farmer, le baron Carra De Vaux, le Syrien Alî Darwîsh et le Tunisien Ahmed al-Wâfi, six tomes sur la musique arabe vont voir le jour : le premier est publié du vivant de son auteur (en 1930), les cinq autres, respectivement, en 1935, 1938, 1939, 1949 et 1959.
Les travaux de d’Erlanger constituent une source d’informations incontournable pour les musiciens et les chercheurs. Le congrès du Caire, dont d’Erlanger a été la cheville ouvrière, a réuni des musiciens d’origines diverses, notamment des Occidentaux, comme Bartok et Hindemith, ainsi que le Turc Raoûf Yekta. Tous ont travaillé côte à côte pour consigner et appeler à la préservation d’un patrimoine qui, en définitive, appartient à l’Humanité tout entière, un patrimoine auquel ont participé aussi bien les Grecs que les Indiens, les Perses et les Arabes, et dont les musiciens et poètes européens du Moyen-ge à l’époque de l’Espagne andalouse se seraient inspirés, les Troubadours, puis les Trouvères et les Minnesänger.
— -





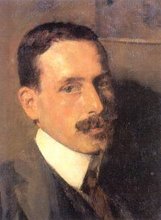


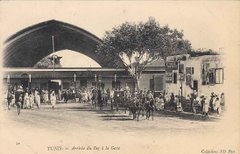

















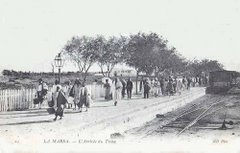

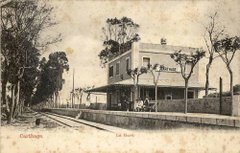


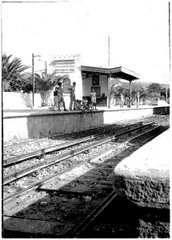
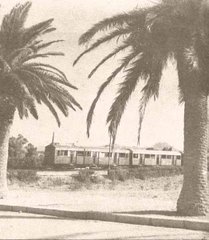













Geen opmerkingen:
Een reactie posten